● Ingénieurs des Mines
AUCOUTURIER, Joseph
BAJAN, Pierre
BARON, Henri
Né le 26 Juin 1918, à MONTPELLIER, de parents commercants, études primaires, double baccalauréat 'MATH.ELEM.' et 'PHILO.LETTRES', classes préparatoires 'MATH.SUP.' et 'MATH.SPE.', puis admissible à POLYTECHNIQUE, il rentre à CENTRALE et aux MINES DE SAINT-ETIENNE en 1939.
Mobilisé le 15 Septembre 1939, campagne de BELGIQUE, retraite de DUNKERQUE, transfert en ALGERIE, démobilisation le 31 Octobre 1941.
Sorti INGENIEUR de l'ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE en mai 1944, il est engagé comme INGENIEUR DU FOND par la COMPAGNIE DES MINES DE LA GRAND'COMBE, ou il sera affecté aux exploitations des mines de LUMINIERE, de CHAMPCLAUSON, puis au siége de RICARD.
En 1948, il est promu INGENIEUR PRINCIPAL responsable du secteur de TRESCOL, à la fois pour le fond et le jour, puis en 1960, il prends le commandement du secteur sud, qui comprends les siéges de ROCHEBELLE, de DESTIVAL, de FONTANES et SAINT-MARTIN DE VALGALQUES, et en 1962 il devient CHEF DES SERVICES GENERAUX de l'ensemble du bassin.
En 1969, aprés les regroupements des bassins, il est appelé à la Direction Générale comme INGENIEUR EN CHEF, pour assumer la centralisation et l'unification de la Gestion des Ingénieurs et Cadres Supérieurs.
En 1976, il devient SECRETAIRE GENERAL des HBCM, et il supervisera l'ensemble des Services Administratifs.
Finalement, c'est en 1980 qu'il fera valoir ses droits à la retraite et se retirera dans sa ville natale de MONTPELLIER, ou il aura une vie sociale très active: Président du Syndicat des Ingénieurs du Bassin des Cévennes, Président du club omnisports de LA GRAND'COMBE, Président régional de la Société des Ingénieurs Civils de France, et Président de l'association INTERMINES ... son action est recompensée en 1988 par sa promotion d'OFFICIER au titre de l'ORDRE NATIONAL DU MERITE, et de l'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES.
En 1988, il rentre à l'ACADEMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER, et puis, ce 29 avril 2002, alors qu’il était dans sa 84ème année, il est décédé dans la maison familiale qu’il occupait, dans la nuit, calmement, sans souffrance, d’un problème cardiaque.
BEAU, Francois
CALLON, Jules

Ancien élève de l'ECOLE POLYTECHNIQUE (promotion 1834, entré major, sorti 2/121) et de l'ECOLE DES MINES DE PARIS (entré 2/5), CORPS DES MINES.
Fils de Pierre Nicolas CALLON, ingénieur, et de Henriette Pauline DESVEAUX, frère de Charles CALLON, ingénieur.
Il épouse en 1847 la fille de Monet de LAMARCK (X, corps des PONTS ET CHAUSSEES), lui-même fils du grand naturaliste LAMARCK.
L'un des fils de Jules CALLON a fait la COUR DES COMPTES. L'autre, Charles Georges CALLON (1852-1937; X 1871) est devenu ingénieur des PONTS ET CHAUSSEES.
Pierre-Jules CALLON, né le 9 décembre 1815, est mort INSPECTEUR GENERAL de deuxième classe le 8 juin 1875. Il a commencé par professer à l'ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE, de 1839 à 1845. Il passa de là dans le GARD, pour fonder l'ECOLE DES MAITRES OUVRIERS MINEURS D'ALAIS, où nous le retrouverons ultérieurement. En 1848, il était appelé à PARIS comme suppléant de COMBES dans la chaire d'exploitation des mines et de machines à l'ÉCOLE DES MINES DE PARIS; en 1856, il en devint titulaire pour le rester jusqu'en 1872. De 1873 à 1875, il a publié son Cours de machines en deux volumes et les deux premiers volumes de son Cours d'exploitation des mines. Ces deux traités, le second particulièrement, sont immédiatement devenus classiques.
En outre de son enseignement et de ses occupations industrielles, CALLON a été rapporteur de la Commission centrale des machines à vapeur; nous verrons le rôle qu'il y a joué en parlant du service des appareils à vapeur.
Pour apprécier l'oeuvre industrielle de CALLON, en dehors de son rôle dans l'enseignement, c'est à peu près sa vie entière d'ingénieur pratiquant qu'il faut suivre. Il y débutait en 1846, alors qu'il était chargé d'organiser l'ECOLE DES MAITRES MINEURS D'ALAIS; il fut autorisé à prendre simultanément la direction des MINES DE LA GRAND'COMBE. Il en resta directeur effectif sur place de 1846 à 1848. Appelé à PARIS à cette dernière date pour professer le cours d'exploitation à l'ECOLE DES MINES, il ne cessa jusqu'à sa mort, en 1875, d'être le guide et l'inspirateur de cette puissante entreprise minière, la plus considérable du midi de la France, soit comme ingénieur-conseil, soit comme administrateur-délégué; les intéressés ont tenu à reconnaître ses services par le buste qui lui a été élevé sur la place principale de LA GRAND'COMBE, au milieu des établissements dont il avait si fortement contribué à fonder la grandeur et la prospérité.
Ces établissements sont particulièrement intéressants, tant par l'originalité et l'importance des moyens employés, encore que simples dans leurs détails, que par leur parfaite adaptation aux conditions du problème; c'est ce bon sens dans les solutions, pourrait-on dire, qui était la marque du génie de CALLON. On devait exploiter à LA GRAND'COMBE, dans un pays très accidenté, avec des altitudes de plus de 500m au-dessus du niveau des vallées, sur de très vastes étendues, des couches puissantes, peu inclinées, affleurant au jour ou situées près du jour. De là les deux particularités saillantes, se reliant du reste l'une à l'autre, de cette entreprise : le vaste réseau de ses voies extérieures avec leurs plans bis-automoteurs et l'organisation des voies souterraines réalisant les uns et les autres le roulage circulaire ou automoteur. Un wagonnet, circulant isolément ou en train, est introduit dans la mine par une galerie, vide, ou après avoir été rempli de remblais à la carrière la plus voisine ; il descend par la seule pente jusqu'au chantier, où il laisse le remblai pour être rempli de charbon ; il continue, toujours par la seule gravité, soit jusqu'au jour, soit jusqu'au bas du puits, où il faut l'élever par la machine d'extraction. La circulation au jour pour aller de la mine aux quais d'expédition, situés à grande distance au fond des vallées, est également automotrice; les wagons pleins descendants remonteront le long des plans inclinés les wagons vides ; mais ceux-ci sont élevés à un niveau supérieur qui permet la circulation automotrice dont nous venons d'indiquer les principes.
Au bout de peu d'années, CALLON fut appelé, par la confiance méritée qu'il inspirait, à être INGENIEUR-CONSEIL d'un très grand nombre d'entreprises industrielles, et, pour plusieurs, son concours, par sa continuité et son importance, équivalait à une sorte de direction technique. C'est ainsi que successivement il fut amené, à partir de 1858, à s'occuper des établissements miniers et métallurgiques constituant la REGIE D'AUBIN, formée par un groupe de mines de houille (CRANSAC), de forges et de mines de plomb (VILLEFRANCHE), que la COMPAGNIE D'ORLEANS avait dû reprendre, dans l'AVEYRON, de la COMPAGNIE DU GRAND-CENTRAL et qu'elle conserva jusqu'en 1870; des établissements métallurgiques de DENAIN et d'ANZIN, dans le Nord; des houillères de RONCHAMP, dans la Haute-Saône; de la houillère de MARLES, dans le Pas-de-Calais; des mines de BELMEZ, en Espagne; des Charbonnages Belges, dans le couchant de MONS. Vers 1870, il cherchait à grouper dans un seul faisceau toutes les entreprises constituées sur le prolongement du bassin houiller de la SARRE, dont nous disions ci-dessus la découverte, lorsqu'il en fut détourné par les cruels événements de l'année terrible.
Ce n'est guère qu'en 1872 que, devenu INSPECTEUR GENERAL, il renonça à suivre une partie de ces affaires; il en garda la plupart jusqu'à sa mort, en 1876. Plusieurs d'entre elles passèrent alors entre les mains de M. Ch.LEDOUX (promotion de 1856 de POLYTECHNIQUE), qui, par son enseignement à l'ÉCOLE DES MINES DE PARIS et sa situation industrielle, devait continuer les grandes traditions de CALLON.
En dehors des entreprises dont il était l'INGENIEUR-CONSEIL, il y eut peu d'affaires importantes intéressant les mines sur lesquelles CALLON n'ait été occasionnellement consulté. Il était recherché partout et par tous pour cette connaissance profonde qu'il avait, jusque dans le détail, de toutes les choses des mines et des machines et pour ce bon sens industriel, comme nous le disions, qui lui faisait appliquer les solutions les plus simples et les mieux appropriées aux conditions du problème : c'est la marque du grand ingénieur.
[Annales]
CURIÈRES de CASTELNAU, Gabriel Antoine Clément
POLYTECHNIQUE (promotion 1868, entré 15 et sorti 3/141), ECOLE DES MINES (sorti 1/4 et promu ingénieur quelques mois avant ses camarades), CORPS DES MINES.
Fils de Michel Mathieu Marie de CURIERES de CASTELNAU (docteur en droit, avocat à SAINT-AFFRIQUE) et de Marie Antonine Léonie Barthe de MANDEGOURG (1824-1898).
Il avait comme frère aîné Léonce, Conseiller Général du Gard puis Député de l'AVEYRON, et comme frère cadet Noël Marie Joseph Edouard, un fameux général ...
Il est né à SAINT-AFFRIQUE le 8 mai 1849 d'une vieille famille du ROUERGUE, qui, de tous temps, fut représentée dans les grands corps de l'État. Il commence ses études au collège Saint-Gabriel près de sa famille, et les termine à PARIS.
Il entre de bonne heure et brillamment à l'ECOLE POLYTECHNIQUE; son rang de sortie lui permet de choisir le CORPS DES MINES: il y est nommé le 1er Novembre 1870 et fait, encore élève, deux voyages d'études en ANGLETERRE.
Il débute dans la carrière comme INGENIEUR ORDINAIRE à MONTPELLIER: des neiges d'une abondance exceptionnelle couvrent brusquement les cévennes: il faut dégager les voies ferrées et personne n'ose monter sur la première machine. Il donne l'exemple et reçoit à cette occasion une MEDAILLE D'OR DE PREMIERE CLASSE.
Il va ensuite à ALAIS, ou le terrible coup de grisou de GRAISSESSAC, en 1877, le met en premier contact avec les dangers de la mine. Il organise aux mines de ROCHEBELLE la lutte contre les dégagements instantanés d'acide carbonique. Après l'accident de FONTANES, son remarquable rapport sur la cause de la catastrophe, qu'il attribue nettement à l'acide carbonique, lui donne sur toute la population ouvrière une très grande autorité. Il sait en même temps lui inspirer une telle confiance qu'elle le choisit plus tard pour défendre ses intérêts au moment de la faillite de la Société de TERRENOIRE et BESSEGES: il réussit à force de patience, d'habileté et d'énergie à faire régler les pensions des ouvriers, tâche qui avait d'abord paru presque inabordable. Il acquiert ainsi une grande réputation, que confirme une lettre de félicitations officielles.Il est fait CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, sur la demande du Conseil Général des Mines, en 1883.
A RODEZ, il passe INGENIEUR EN CHEF le 1er octobre 1887. Dans le bassin de l'AVEYRON, il ne tarde pas à utiliser à nouveau ses remarquables facultés. Depuis le meurtre de l'ingénieur VATRIN, le grand centre industriel de DECAZEVILLE, était dans un état très critique; il sait y ramener l'ordre. Il se plait, à proximité de sa famille et de ses propriétés.
Mais, homme de devoir avant tout, il n'hésite pas à sacrifier ses convenances et ses intérêts pour aller occuper le poste difficile de SAINT-ETIENNE. Peu après son arrivée dans la LOIRE a lieu la terrible explosion de grisou du Puits de La Manufacture (3 décembre 1891) qui coûta la vie à une soixantaine d'ouvriers. Aussitôt, aidé des ingénieurs, il parcourt les galeries effondrées, à la recherche des victimes, entraînant à sa suite les mineurs les plus hésitants, avec un courage et un dévouement communicatifs qu'on n'a pas oubliés et qui le fit citer à l'ORDRE DU CORPS NATIONAL DES MINES par décision présidentielle du 29 mai 1893. A la suite de cet accident, la population de SAINT-ETIENNE a appris à l'estimer et à l'aimer, ce qui facilite singulièrement sa tâche auprès des Compagnies. Il peut ainsi mener à bien, avec les seules ressources de l'industrie privée, la fondation de l'ÉCOLE DES ASPIRANTS-GOUVERNEURS, fondation féconde, bien vivante encore aujourd'hui.
En 1893, il devient Directeur de l'ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE, et le temps de son séjour à CHANTEGRILLET a laissé le souvenir d'une période particulièrement brillante.
Trois ans après, en 1896, séduit par l'offre qui lui est faite de diriger à son tour, d'après ses idées, une de ces grandes exploitations qu'il a jusqu'ici contrôlées avec tant d'autorité. Il entre à la COMPAGNIE DES MINES DE LA GRAND'COMBE. Dès lors, il se consacre tout entier à l'industrie. Son activité exceptionnelle lui permet d'être aussi l'INGENIEUR-CONSEIL des Mines de GRAISSESSAC, de CAMPAGNAC, (d'une conduite si délicate à cause du grisou et des feux), puis de celles de VICOIGNE et de NOEUX, où il améliore la méthode d'exploitation, l'aérage et le remblayage, supprime les goyaux, fait restreindre de plus en plus l'emploi des lampes à feu nu dans toutes les couches de charbon gras ou demi-gras. En même temps, à LA GRAND'COMBE, il donne à l'exploitation une direction et une impulsion toutes nouvelles, transforme l'outillage et contribue à assurer les retraites des ouvriers.
Les électeurs du canton, presque à l'unanimité, l'envoient à NIMES, en 1898, au Conseil Général, où il les représentera sans interruption jusqu'à sa mort.
Entre temps, il préside la société métallurgique de VEZIN-AULNOYE, s'occupe encore de recherches minières, est chargé de missions en Espagne et en Pologne russe, dirige la rédaction de l'énorme rapport du jury des Mines à l'Exposition de 1900.
Après la catastrophe de COURRIERES, il fait partie de la commission qui fixe le plan de remise en état des fosses ravagées. A la nouvelle de sa mort si imprévue, l'émotion se peint sur bien des visages : de nombreux ouvriers à LA GRAND'COMBE, viennent, les larmes aux yeux, manifester spontanément à leur ingénieur toute leur sympathie.
FUMAT, Victor-Adrien
Ancien élève de l'ECOLE DES MINES de SAINT ETIENNE (promotion sortie en 1863). Ingénieur civil des MINES.
Victor FUMAT est surtout connu pour avoir été directeur des mines de la GRAND'COMBE dans les années 1880-1890, où il mit au moins le type de lampe de mineur qui porte son nom.
Né le 18 mars 1842 à CORNAS (Ardèche), il entre en 1863 aux mines de fer de VILLEBOIS (Ain), puis un an plus tard aux mines de LA GRAND'COMBE (Gard). Il y devint INGENIEUR PRINCIPAL (1874), DIRECTEUR (1879) et il quitte cette société en 1897, pour prendre un poste d'INGENIEUR EN CHEF aux mines d'OSTRICOURT (Pas-de-Calais), devenant là encore conseiller municipal en 1902.
En 1870, il a été victime d'une explosion de grisou au puits de LA FORET.
Nommé pendant la guerre de 1870 CAPITAINE des mobilisés de LA GRAND'COMBE, il est élu en 1872 au conseil municipal de cette ville, où il devient de 1881 à 1897 adjoint au maire.
Outre son invention d'une lampe de sûreté pour mineurs, on lui doit la publication de diverses recherches géologiques dans le Gard.
Il participe avec AGUILLON et MURGUE à des commissions d'études sur le bassin houillier, et avec ZEILLER et GRAND'EURY à des recherches de houille à la LA GRAND'COMBE.
La ville de LA GRAND'COMBE donné son nom à une rue.
Il est enterré au cimetière d'OIGNIES (Pas de Calais).
[Annales]
GRAFFIN,
Ancien élève de l'ECOLE DES MINES DE PARIS (promotion 1849), ingénieur civil des MINES.
Né à PARIS en 1829, il était de la promotion de 1849, et dés sa sortie de l'ÉCOLE DES MINES DE PARIS, il arrive à LA GRAND'COMBE, le 15 Juillet 1852, et entre en Août 1852 aux mines de la Grand'Combe, où il fit toute sa carrière pendant 46 années consécutive: en 1856, il est nommé INGENIEUR PRINCIPAL, en 1863, il prends le titre et les fonctions de DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION, sous la Direction Générale de Monsieur François BEAU, puis, en 1867, à la suite de l'Exposition Universelle, la Croix de CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR lui était décernée. Douze ans plus tard, en 1879, il était nommé DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE et, en 1896, le titre de DIRECTEUR GENERAL lui était conféré.
Il fut aussi Conseiller Municipal 42 ans, Maire 30 ans, et Conseiller Général pendant 18 années: Conseiller Municipal de LA GRAND'COMBE le 8 août 1855, il était nommé Maire le 18 avril 1868 et n'a pas cessé d'être depuis lors à la tête de la municipalité. Élu Conseiller d'Arrondissement le 4 octobre 1874, il était appelé au Conseil Général le 14 décembre 1879, par le choix des électeurs du canton qui n'ont pas cessé de lui conserver leur confiance.
Dirigé par Monsieur BEAU, et conseillé par Jules CALLON, il a réalisé dans l'exploitation de nos mines de grands progrès. C'est sous son commandement que l'ancienne méthode par piliers et galeries a été remplacée par la taille chassante avec remblais complets, que le roulage circulaire déjà pratiqué pour les transports à la surface a été appliqué aux transports souterrains des remblais et du charbon et que la ventilation mécanique a, de très bonne heure, remplacé la ventilation naturelle et le foyer.
Il est l'auteur d'un lavoir à charbon qui porte son nom: imaginé vers 1860 cet appareil a reçu, sous son inspiration, des perfectionnements successifs importants et il est encore employé dans nos ateliers avec avantage. Il a aussi, le premier en France, croyons-nous, fait l'application, en 1871, dans les ateliers de surface, des toiles de transport.
GRAFFIN était donc un initiateur ingénieux et habile, il était surtout un chef intelligent et énergique, il avait à un haut degré le don du commandement. D'une très grande activité, il exerçait ses fonctions d'INGENIEUR PRINCIPAL ou de DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION par une action de présence presque continuelle sur les travaux. D'un caractère très ferme et bienveillant, d'une humeur aimable, enjouée, toujours égale, il savait inspirer à ses subordonnés la confiance, l'affection et le respect. Il avait d'ailleurs pour sa GRAND'COMBE les sentiments d'un profond attachement; il aimait ce pays comme s'il y était né; il avait des regards complaisants pour ses cîmes rocheuses et ses pentes boisées. Pour son personnel, il avait les sentiments d'un père. Il en connaissait presque toutes les familles; il se réjouissait de leurs joies, il prenait part à leurs peines et savait leur témoigner l'intérêt bienveillant et discret que son excellent coeur lui inspirait.
Il a participé à l'établissement des institutions de prévoyance patronale dont la Compagnie, bien avant les lois sociales actuelles, avait doté LA GRAND'COMBE pour protéger ses ouvriers et leurs familles contre les conséquences de la maladie, de l'accident et de la vieillesse, mais c'est à lui que la population doit la fondation sur des bases nouvelles de la Société de Prévoyance qui, depuis 1890, assure aux ouvriers de LA GRAND'COMBE, des retraites supérieures à celles que les mineurs des entreprises similaires peuvent espérer...
LAUNAY (de), Louis
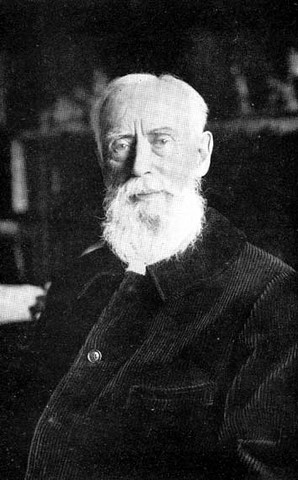
Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise.
1920: Président du Conseil d'administration de la Compagnie des Mines de LA GRAND'COMBE.
MARCEAU, Jean-Baptiste

MARSAUT entra à l'ECOLE DES MINES de SAINT ETIENNE en 1850, à l'âge de dix-sept ans seulement.
A sa sortie de l'école, il passa deux, années aux mines de VIALAS, « à chercher de la galène dans des filons, à la débarrasser de sa gangue, à la traiter pour en tirer le plomb d'oeuvre et les lingots d'argent qui faisaient alors la prospérité de ces mines » (Discours du cinquantenaire).
En même temps, il était chargé de la direction de la petite mine de houille de COMBEREDONDE. Cette exploitation était confiée à un maître-mineur qui, selon MARSAUT, n'était guère plus fort que lui-même dans le métier.
Le jeune ingénieur passait une semaine chaque mois à « régler les comptes et donner quelques directives de chantiers dans la célèbre couche de Champclauson, avec l'antique boussole carrée, le principal instrument de topographie souterraine de l'époque » (Discours du cinquantenaire).
Dès l'aube de sa carrière, MARSAUT s'intéressait à l'importante question de l'éclairage des mines grisouteuses. « Je ne me rappelle ce temps, a-t-il dit, qu'avec une frayeur rétrospective en pensant qu'alors je m'intéressais à produire dans la grosse lampe Davy de La Grand-Combe de petites explosions de grisou pour constater la manière dont ce gaz se comporte dans la lampe de sûreté. C'est bien le cas de dire que s'il faut de la jeunesse pour pratiquer le métier de mineur, pas trop n'en faut. »
Le 1er novembre 1854, sur recommandation de son ancien professeur PARRAN, il devenait ADJOINT de CHALMETON aux mines de BESSEGES. Il devait y faire toute sa carrière, épouser une nièce de CHALMETON et lui succéder comme DIRECTEUR de la compagnie.
En 1845, CHALMETON, tout jeune ingénieur, avait pris la mine de BESSEGES des mains d'un vieux maître-mineur allemand, le Père Christophe. Celui-ci laissait derrière lui un souvenir brûlant : il avait, en gaspillant la belle couche de Saint-Ylide, provoqué un feu souterrain qui devait brûler pendant plus de soixante ans !
CHALMETON avait, en prenant sa suite, aménagé rationnellement les couches de la montagne SAINT-LAURENT, qui affleuraient au jour et donnaient un charbon gras d'excellente qualité. Lorsqu'après la Révolution de 1848 l'industrie française prit un remarquable essor, la mine était prête pour lui assurer des tonnages substantiels de houille.
Il s'agissait de faire passer l'extraction de 75.000 à 175.000 tonnes pur an. C'est alors que CHALMETON eut besoin d'un adjoint et que MARSAUT entra à la compagnie de BESSEGES.
L'exploitation préparée par CHALMETON était concentrée dans la montagne SAINT-LAURENT. L'ossature de la mine comportait simplement deux plans inclinés automoteurs de surface. L'un descendait le charbon du troisième niveau au deuxième, où se trouvait un atelier de criblage primitif et des lavoirs semi-mécaniques qui alimentaient des hauts fourneaux. L'autre amenait le charbon du deuxième niveau au carreau de la mine, où les consommateurs venaient s'approvisionner. Le combustible qui n'était pas écoulé sur place était transporté à ALAIS sur charrettes, par des routes défoncées. Le chemin de fer ne fut installé qu'en 1858.
Dès son arrivée, MARSAUT prépara d'autres sièges d'exploitation : celui de GREAL et celui de MOLIERES, et fonça des puits pour sonder la base de la montagne SAINT-LAURENT.
L'aménagement du siège de MOLIERES posait des problèmes nouveaux. Il s'agissait de couches d'une minceur telle que partout ailleurs on les eût considérées comme inexploitables.
MARSAUT fit un voyage d'études à ANZIN et en BELGIQUE pour s'initier à la technique d'exploitation des couches minces. A son retour, il sut dépasser ses maîtres et mettre en valeur des couches d'une épaisseur de moins de 0 m 50 grâce à une technique et à un outillage originaux. Il sut notamment utiliser la pression du toit pour faciliter l'abatage, en évitant tout travail pénible de havage ou d'entaillage.
Le siège de MOLIERES, créé entièrement par MARSAUT, devait devenir, en dépit de la minceur des couches, le centre le plus important de la compagnie de BESSEGES. Avant lui, ce n'était qu'un pauvre hameau de quarante habitants. En 1905, c'était un centre industriel important, où travaillaient 1.700 ouvriers.
CHAMELTON était absorbé par les activités extra-minières de la compagnie de BESSEGES, qui comptait de nombreux établissements métallurgiques dans le Gard, l'Ardëche (La Voulte) et la Loire (Terrenoire). Pratiquement, dès 1855, MARSAUT fut seul à conduire la mine. En 1862, CHAMELTON quittait BESSEGES pour installer le siège de la direction générale à NIMES, et MARSAUT, âgé d'à peine vingt-neuf ans, était officiellement chargé de la direction de la mine.
A cette époque, il avait réussi à porter la production à 300.000 tonnes par an. MARSAUT eut alors à son tour besoin d'adjoints. La mine devint de plus en plus importante.
MARSAUT creusa de nombreux puits et les pourvut de puissantes machines à vapeur. Il établit une « colossale ossature » de galeries et travers-bancs qui explorait toute la concession sous les montagnes du FEL, de SAINT-FLORENT et de MONTALET. Il introduisit au fond des locomotives.
Il assura le transport du personnel par des « funiculaires souterrains qui rivalisent de confortable et de sécurité avec ceux des Alpes » (MURGUE).
Toujours dans le domaine du transport du personnel, qui l'intéressait particulièrement, il inventa un parachute très efficace pour garantir la circulation des ouvriers dans les puits.
Dans le domaine de l'exploitation proprement dite, après avoir imaginé la méthode des grandes tailles en couches très minces, à MOLIERES, il conçut la méthode dite « de chambardement », qui permit de lutter contre un grave danger local, celui des dégagements spontanés de gaz carbonique. L'administration, d'abord hostile à ce procédé, qui consistait à secouer la mine par de fortes charges d'explosifs puissants, finit par le recommander et même par l'imposer dans les mines à dégagements instantanés.
Au jour, MARSAUT créa d'importants ateliers de manutention, de préparation, d'épuration et d'agglomération, appropriés au niveau de la production, passée à quelque 500.000 tonnes par an au début du siècle.
Il a installé à MOLIERES une des premières centrales électriques minières.
En somme, MARSAUT a vérilablement créé l'exploitation moderne de BESSEGES.
'Mais il a aussi rendu service aux mineurs de tous les pays par sa plus belle invention : celle de la cuirasse pour lampe à flamme. Tout au long de sa carrière, il ne cessa d'étudier ce problème de l'éclairage en milieu grisouteux, sur lequel il s'était penché avec sa naïveté d'ingénieur tout frais sorti de l'école. Il fut plus d'une fois grièvement brûlé au cours de ses expériences.
A force d'études, de longues mises au point expérimentales, il finit par préciser « la forme et les dispositions qui donnent aujourd'hui à la lampe de sûreté des mineurs la merveilleuse propriété, que l'on a si longtemps recherchée, d'assurer une sécurité complète dans les milieux inflammables ».
La lampe MARSAUT fut reconnue pour efficace par toutes les commissions officielles des pays miniers d'Europe. En particulier, des expériences faites à FRAMERIES par les méticuleux ingénieurs de l'Etat belge les amenèrent à proscrire, après vingt ans d'hésitation, leur lampe nationale et à imposer la lampe du type MARSAUT.
Comme chef, il était du type rude et bourru. Son collaborateur MURGUE alla jusqu'à parler, en un banquet officiel en l'honneur de MARSAUT, « des épreuves parfois un peu dures d'une longue subordination ».
Cependant, MARSAUT savait prendre ses responsabilités et couvrir ses subordonnés. Il inspirait confiance à tout son personnel. On disait : « M. Marsaut est juste; il fait le droit de l'ouvrier. » Il a dit lui-même qu'il s'était toujours préoccupé « de tenir les salaires à la hauteur des meilleurs salaires français, d'écarter par une réglementation disciplinaire large, laissant à l'ouvrier toute son indépendance et sa dignité, toutes les petites choses qui ne font que le froisser sans utilité, comme les mises à pied, les retenues mesquines, les fautes tarifées par des amendes ». C'est avec la même largeur d'esprit qu'il organisa des caisses de secours et de retraites qui servirent de modèle au législateur.
Plus qu'au prix Monthyon, plus qu'à sa croix de la LEGION D'HONNEUR, il fut sensible aux marques d'attachement qui lui vinrent de ses ouvriers; en 1883, en pleine période de grèves minières, qui épargnèrent le siège de MOLIERES, il reçut de son personnel ouvrier un bronze d'art; en 1905, lors de la célébration du cinquantenaire de son entrée à la compagnie, les ouvriers participèrent, contre sa volonté, à l'offrande de son propre buste.
A cette occasion, MAZODIER, ingénieur en chef des mines de LA GRAND'COMBE, déclarait dans son toast : « On peut résumer votre oeuvre, monsieur Marsaut, en disant que votre existence est un véritable cours d'exploitation des mines. En effet, parmi tous les problèmes que pose cette exploitation, il n'en est presque pas un seul auquel vous n'ayez apporté votre solution personnelle. »
.
MATHET, Francois
Quand, à l'âge de soixante-treize ans, en 1896, il résigna ses fonctions actives et quitta BLANZY, après quarante-quatre années de service dans les houillères, ce ne fut point encore pour prendre un repos pourtant bien mérité, ce fut pour aller porter, aux entreprises françaises à l'étranger, en Espagne, en Pologne, les lumières de son expérience.
Il est l'auteur d'un très important ''Mémoire sur les mines de Ronchamp'' publié en 1881; c'est le document le plus important jamais écrit sur les mines de RONCHAMP ! Ce Mémoire était en grande partie rédigé avant son départ de RONCHAMP et il le terminera pendant son affectation à BLANZY. De ses 19 années passées à RONCHAMP, il a assisté et coopéré à une transformation complète des mines, où la production est passée de 50.000 à 200.000 tonnes et sa conclusion laissait un grand message d'espoir..
MAZODIER, Joseph
NIVOIT, Edmond
SOUBEIRAN (de), Louis Joseph Alfred

Fils de Charles Léon SOUBÉIRAN, avoué, et de Marie Louise SUFFET.
SOUBEIRAN succéda à OLRY comme ADMINISTRATEUR de l'Institut Industriel du Nord (1885-1891), où il enseigna par ailleurs la mécanique.
En 1892, il devient INGENIEUR-CONSEIL des mines de BRUAY et de l'ESCARPELLE, ainsi que de la société des mines de BLANZY. Il devient ensuite ADMINISTRATEUR des mines de CAMPAGNAC.
En 1908, il démissionne de l'administration et termine ainsi sa carrière administrative comme INGENIEUR EN CHEF des mines. Il succède à CLEMENT DE CASTELNAU comme ADMINISTRATEUR des mines de LA GRAND'COMBE.
TURPIN, Marcel
La démolition de la derniére partie du FESC, fait revivre en eux le souvenir de celui qui fut le père, ils veulent parler de Michel TURPIN.
En 1919, libéré des camps de prisonniers, il s'embauche à la compagnie des mines de LA GRAND'COMBE. Durant toute sa carrière, il restera fidèle à cette société.
Il est affecté à "LA PISE", au service construction. Son employeur ayant reconnu ses mérites, il est rapidement promu INGENIEUR DIVISIONNAIRE, puis INGENIEUR PRINCIPAL des travaux du jour, le 01 Septembre 1934, succédant à Monsieur REGERAT admis à la retraite, qui soit dit en passant, ne quittera pas LA GRAND'COMBE, et finira ses jours, très âgé, dans sa maison rue de LA PISE.
Avec Monsieur GODARD, promu DIVISIONNAIRE à la construction, et Monsieur MARION, pour DIVISIONNAIRE chargé des usines, il a donc contribué:
- à la bonne marche de l'atelier central,
- la centrale PISE et son réseau électrique,
- la marche de l'agglomération PISE et du lavoir à charbon,
- la modernisation des machines d'extraction,
- l'étude des nouveaux ateliers de traitement des charbon de RICARD,
- l'étude d'un nouveau puit aux OULES,
- et d'une Centrale électrique à construire, la guerre terminée.
A la création des H.B.C. en 1946, il est nommé INGENIEUR EN CHEF des H.B.C. et chargé de la construction de la nouvelle centrale qui se fera au FESC. Il quittera les H.B.C. en 1954, aprés la mise en service du Groupe N°3.
Il eut la satisfaction de voir l'achèvement de son oeuvre à laquelle il s'était beaucoup donné.
Homme de grande rigidité dans son travail, il fut nommé en 1951 CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, pour services rendus à l'industrie houillére.
Il est décédé en 1958.
Encore beaucoup d'anciens Grand'Combiens se souviennent de lui et de sa famille.
[un ancien de son service]


